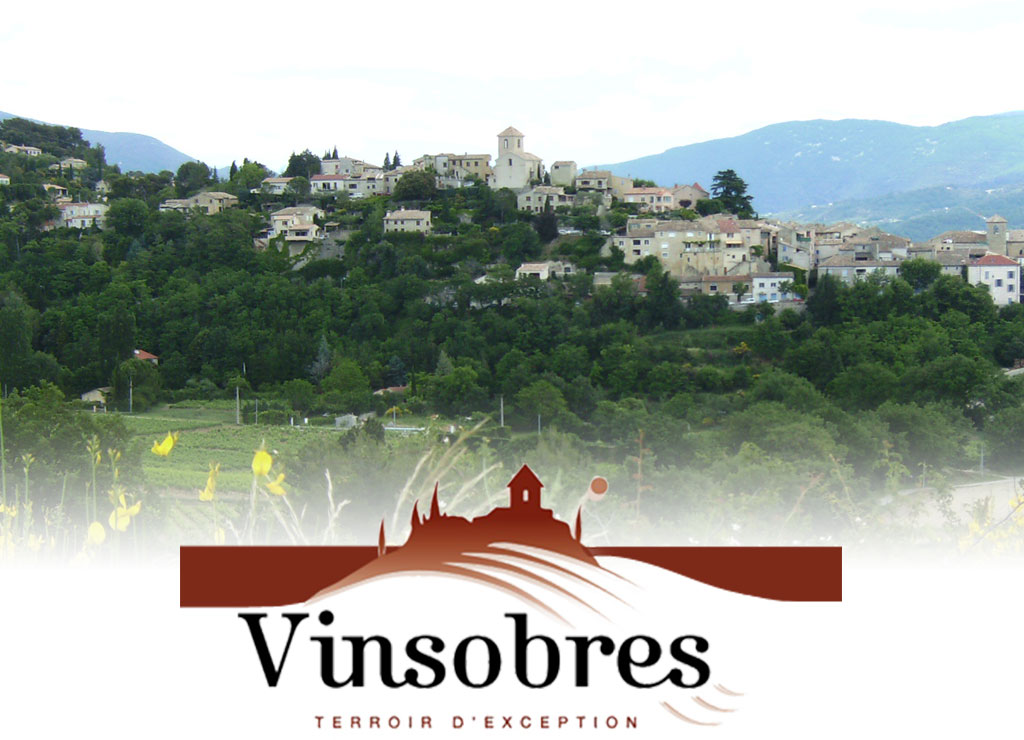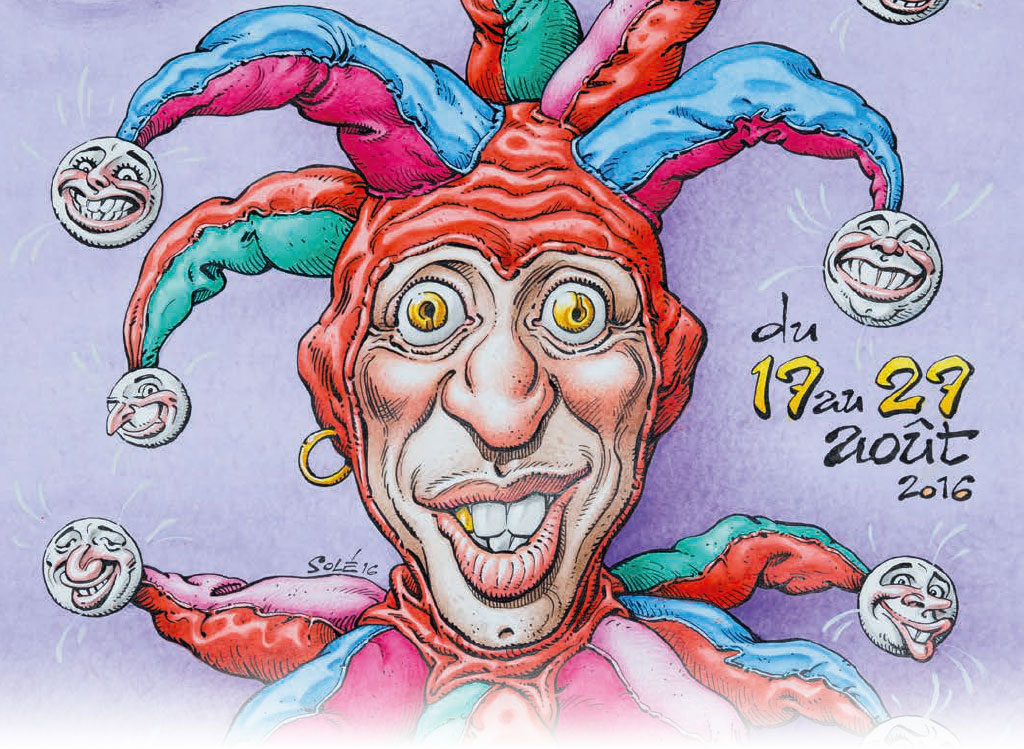La lettre de Décembre 2019
Événements
Les Rencontres du Livre, de la Truffe et du Vin à Grignan les Adhémar
Du 31 Janvier au 02 Février 2020
En savoir plus
Décryptage
Trois facteurs concourent à la contraction des achats de vin : la perte d’acheteurs (- 400 000 foyers en 2017), la diminution de la fréquence des achats (de 15,1 à 13,8 fois par an) et surtout, la baisse des volumes achetés (de 53,9 à 46,5 col/an). La perte d’acheteurs se fait sentir surtout sur les rouges et les blancs. Les rosés, en revanche, retrouvent de l’attractivité́ après une saison 2016 difficile. Ils constituent la seule couleur pour laquelle le budget d’achat progresse sur le long terme. Si les prix des vins suivent une courbe ascendante et si les vins les plus chers résistent davantage à la déconsommation, la dépense a néanmoins diminué de 3,2 % entre 2016 et 2017. L’étude porte sur les achats destinés à la consommation à domicile.
Dossier
Des vins « sans » en quête d’autres sens
Sans pesticides de synthèse, sans résidus de pesticides, sans sulfites, sans traces de produits animaux, voire sans alcool... : la filière vinicole multiplie les initiatives pour tenter de répondre à de nouvelles quêtes de sens.

Avec près de 500 signes officiels d’origine et de qualité (AOP, AOC, IGP...), les vins et spiritueux français figurent parmi les produits agroalimentaires les mieux identifiables au monde. L’histoire remonte à 1935. Plus récemment, diverses mentions sont venues compléter l’information donnée aux consommateurs, à commencer par le label Agriculture Biologique (AB), intronisé en 1991 avec le règlement européen. En 2018, le logo AB figurait sur plus d’une bouteille sur dix, le vignoble français étant certifié à hauteur de 12 %. Ce logo AB est en fait l’ancêtre des mentions « sans », en l’occurrence sans pesticide de synthèse. En 2017, toujours dans le registre des produits phytosanitaires est apparue la mention « zéro résidu de pesticides », à l’initiative de plusieurs organisations de producteurs de fruits et légumes, réunies au sein du collectif Nouveaux Champs. Elle essaime aujourd’hui dans la filière vinicole, avec le ralliement tout récent de quelques caves coopératives, qui s’apprêtent à commercialiser leurs premières cuvées.
Troisième voie
Pour chaque substance active, la garantie d’absence de résidu s’entend comme étant inférieure à la limite de quantification par des laboratoires accrédités (Cofrac), soit 0,01mg/kg dans l’état actuel des techniques d’analyse, donc en-deçà des limites maximales en résidus (LMR). Les analyses ciblent les matières actives homologuées sur la culture labellisée mais pas seulement. Celles retirées du marché mais rémanentes, celles controversées, celles pouvant provenir de cultures environnantes ainsi que les métabolites de dégradation dont les résidus sont réglementés sont également traquées. Les lots sont systématiquement analysés tandis que les pratiques des agriculteurs engagés sont contrôlées, selon des procédures indépendantes et certifiées. La démarche s’inscrit dans une approche globale de la conduite culturale, visant à réduire en amont le recours aux pesticides via différents leviers techniques et agronomiques (variétés résistantes, auxiliaires...). Elle se pose en troisième voie, aux côtés de l’agriculture conventionnelle et de l’agriculture bio, en étant porteuse d’obligations de résultats et pas seulement de moyens.
Segmentation sans modération
Les mentions « sans » ne concernent pas que les pesticides et pas que le raisin. Au chai, les cuvées garanties sans sulfites ajoutés ont aussi le vent en poupe. C’est également à la cave que se joue l’élaboration de cuvées véganes, bannissant le blanc d’oeuf, la caséine de lait, le miel, ou encore de la gélatine de boeuf ou de porc, utilisés pour agglomérer les lies en suspension après la fermentation, et remplacés par des protéines végétales, de la poudre d’algues ou encore de l’argile. Dans les vignes, les amendements à base d’effluents d’élevage sont alors proscrits ainsi que le pâturage des animaux. Dernière catégorie des mentions « sans » : les vins sans alcool qui, même s’ils ne peuvent être dénommés « vins », n’en séduisent pas moins les consommateurs. Selon Kantar Worldpanel, les ventes de boissons tranquilles et effervescentes sans alcool ont augmenté respectivement de 12,3 % et 3,7 % en 2018. L’ensemble de ces mentions contribue à segmenter toujours plus finement l’offre de vins et vise peut-être à contrarier, in fine, l’érosion de la consommation. Des vins « sans » mais dénués ni de sens, ni de sensations.
Focus
L'ABSINTHE DE PONTARLIER DECROCHE SON IG
L’INAO avait approuvé son cahier des charges en 2012, la Commission européenne vient d’en faire sa 238ème Indication géographique (IG) dans le domaine des boissons spiritueuses. L’absinthe de Pontarlier est principalement produite à partir d’anis vert en grains et de « grande absinthe », la plante dont le principe actif, la thuyone, lui procure ses arômes propres. Boisson à la réputation sulfureuse, l’absinthe avait été interdite en 1915 avant d’être partiellement réhabilitée en 1988 puis totalement en 2011. Elle ne peut être produite que dans 20 communes du Haut-Doubs situées autour de la ville de Pontarlier, communes dans lesquelles ont lieu la culture et le séchage de la grande absinthe, les opérations de macération des plantes, de distillation du macérat, d’élaboration de la boisson spiritueuse ainsi que son conditionnement.


Rencontre
« Une transition alimentaire qui impacte la consommation de vin »
Avec Marie- Henriette Imberti, Déléguée aux affaires économiques du CNIV*
Les comportements alimentaires, à domicile et hors domicile, rebattent les cartes de la consommation de vin en France. L’essor du bio ne compense pas la baisse tendancielle mais permet de capter les nouvelles générations.
Comment évolue la consommation de vin en france ?
Marie-Henriette Imberti : elle est orientée à la baisse depuis des décennies. Cette tendance s’observe sur tous les marchés matures tels que l’Espagne et l’Italie, autres grands pays producteurs. Elle mérite cependant d’être relativisée. La France demeure le 2ème pays consommateur de vin au monde, derrière les Etats-Unis. Plus de 8 foyers sur 10 achètent du vin, ce qui représente plus de 23 millions d’acheteurs. En valeur, le marché progresse, porté par la hausse des prix.
Blanc, rouges, rosés, effervescents : quels sont les plus concernés ?
M-H.I. : toutes les catégories de vins sont impactées. La déconsommation à l’oeuvre n’est pas propre aux vins mais à l’alcool en général. Une étude en cours nous permettra d’affiner notre analyse, s’agissant notamment des rouges en entrée de gamme, les plus concernés par la baisse de consommation. Parmi nos hypothèses figurent les changements de comportement alimentaire. Les repas à domicile sont moins nombreux, le contenu de notre assiette change et se déstructure. Les repas sont moins complexes, la viande est moins présente, l’apéritif se développe.
Les nouveaux circuits d’achat changent-ils la donne ?
M-H.I. : les achats sur internet soutiennent la consommation même si le chiffre d’affaires, de l’ordre de 500 millions d’euros pour les vins, progresse de façon moins exponentielle que par le passé. On assiste dans cet univers à un phénomène de concentration des opérateurs et à une diversification des offres proposées par chacun d’eux. Au-delà de l’internet, les comportements d’achat changent également, les consommateurs français tendant à se détourner des grandes surfaces. Ils fragmentent davantage leurs achats, achètent davantage en local, ce qui peut conduire indirectement à des détournements d’achats de vin.
Le bio est il de nature à inverser la tendance ?
M-H.I. : la consommation de vin bio poursuit sa progression. En 2018, 13 % des foyers étaient consommateurs contre 4 % en 2011. La demande reste soutenue mais ce n’est pas le vin bio qui va inverser la courbe de consommation du vin. Le bio permet de toucher toutes les tranches d’âge de consommateurs. Les acheteurs de vin bio sont proportionnellement plus jeunes que l’ensemble des acheteurs.
(*) Comité national interprofessionnel des vins à appellation d'origine et à indication géographique.